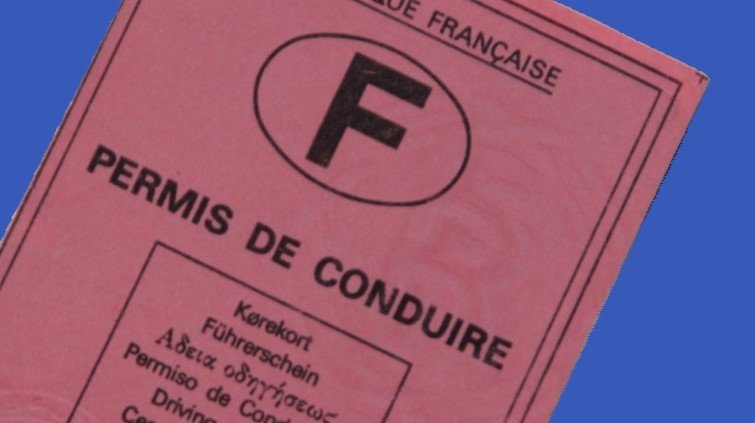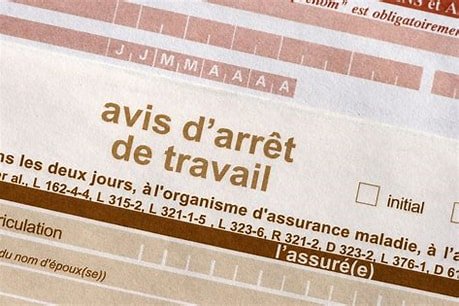Démission du gouvernement de Gabriel Attal qui assure « le traitement des affaires courantes »
Le mardi 16 juillet 2024, le président de la République a accepté la démission du gouvernement de Gabriel Attal, comme l’a annoncé l’Élysée dans un communiqué. Cependant, selon une note récente du Secrétariat général du gouvernement (SGG), un gouvernement démissionnaire reste en place tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau gouvernement.
Le chef de l’État, Emmanuel Macron, a approuvé la démission du gouvernement de Gabriel Attal, comme l’a annoncé l’Élysée dans un communiqué daté du 16 juillet 2024.
Quelles sont les compétences du gouvernement après sa démission ?
Selon la tradition républicaine, un gouvernement peut prendre fin par une démission collective présentée par le Premier ministre au président de la République.
Le gouvernement conserve toutes ses prérogatives jusqu’à ce que le décret présidentiel actant sa démission entre en vigueur, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Toutefois, le gouvernement de Gabriel Attal restera en fonction avec des compétences restreintes pour assurer le traitement des affaires courantes jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit nommé.
Toutefois, le gouvernement de Gabriel Attal restera en fonction avec des compétences restreintes pour assurer « le traitement des affaires courantes » jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit nommé. En effet, comme l’indique une note du Secrétariat général du gouvernement en date du 2 juillet 2024, « un gouvernement démissionnaire reste en place tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau gouvernement, pour assurer, au nom de la continuité, le fonctionnement minimal de l’État« .
Qu’est-ce que l’expédition des affaires courantes ?
Sous la IVe République, cette notion juridique était inscrite à l’article 52 de la Constitution du 27 octobre 1946 : « en cas de dissolution, le Cabinet, à l’exception du président du Conseil et du ministre de l’intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes« .
Sous la Ve République, l’expression est présente dans la jurisprudence administrative.
Par exemple, la décision du Conseil d’État du 4 avril 1952, a annulé un décret pris par un gouvernement démissionnaire. Le juge administratif avait estimé « qu’en raison de son objet même, et à défaut d’urgence, cet acte réglementaire qui devait, non pas appliquer simplement mais transposer en Algérie, compte tenu des circonstances locales, le système de la loi du 11 mai 1946, et fixer les règles de droit applicables aux actes individuels de transfert à intervenir ultérieurement, ne peut être regardé comme une affaire courante, si extensive que puisse être cette notion dans l’intérêt de la continuité nécessaire des services publics ».
L’expédition des affaires courantes se limite aux mesures permettant d’assurer le fonctionnement régulier de l’administration et la continuité des services publics (organisation des services, paiement de dépenses engagées…).
Le gouvernement peut prendre des décrets, des arrêtés et des circulaires pour mettre en application des lois déjà votées (les principes ayant été posés antérieurement à la cessation des fonctions). Ces actes ne relèvent pas d’un pouvoir d’initiative politique.
En cas de circonstances exceptionnelles, le gouvernement pourrait néanmoins prendre des mesures imposées par l’urgence.
Quelle est la durée d’expédition des affaires courantes ?
Selon la note du Secrétariat général du gouvernement en date du 2 juillet 2024, sous la Ve République, les périodes d’expédition des affaires courantes ont été courtes (neuf jours au maximum en 1962). Ces périodes ont été plus longues sous la IVe République (quinze jours en moyenne avec cinq périodes ayant excédé un mois).